Henri Roorda, A prendre ou à laisser, Le programme de lecture du professeur d’optimisme, postface de Eric Dussert, Editions Mille et une nuit, 2012 (lu par Michel Cardin)
Par Cyril Morana le 15 janvier 2013, 06:54 - Philosophie politique - Lien permanent

Henri ROORDA, À prendre ou à laisser, Le programme de lecture du professeur d’optimisme, Postface de Eric Dussert, Editions Mille et une nuit, septembre 2012.
Henri Roorda est né à Bruxelles en 1870, mais a vécu surtout dans le canton de Vaud, où son père, Sicco Roorda van Eysinga, d’abord fonctionnaire hollandais à Java, puis journaliste et écrivain anarchiste, avait trouvé refuge en 1872, suite à ses positions anti-colonialistes.
Sicco reste proche de nombreux communards et anarchistes exilés en Suisse, comme les géographes et savants Elisée Reclus, Metchnikoff et Kropotkine. Comme le montre son livre Anarchistes de père en fils, Henri Roorda poursuit dans la voie tracée par son père en fréquentant lui aussi les milieux anarchistes à Lausanne et en partageant leurs critiques radicales du monde dans lequel ils vivent. Son engagement pédagogique, ses chroniques et son œuvre pamphlétaire en témoignent.
Il écrit ainsi, sous le nom de Balthasar, le « professeur d’optimisme », des chroniques humoristiques, fort appréciées des lecteurs, dans « La Tribune de Lausanne », puis « La Gazette de Lausanne ». Elles sont reprises dans A prendre ou à laisser en 1919. Il poursuit dans cette veine à « La Tribune de Genève » mais aussi dans ses Almanachs. Il participe parallèlement à d’autres publications anarchistes entre 1917 et 1925, en s’engageant en particulier avec Ramuz dans les « Cahiers vaudois ».
S’il s’exerce à l’écriture d’une pièce de théâtre, qui sera jouée en 1924 - Le silence de la bonne, pièce en un acte -, c’est son travail comme professeur de mathématiques, à partir de 1892, et ses réflexions sur l’école qui forment l’autre partie de son œuvre. Il refuse ainsi les contraintes du système scolaire et la stérilité des modes de transmission du savoir, imposant aux élèves une normalisation de l’esprit ; et il se met au service d’une pédagogie libertaire : pratique innovante de son métier, mais aussi pamphlets, dès 1898 comme L’Ecole et l’apprentissage de la docilité, puis L’Ecole et le savoir inutile, en 1903, Le pédagogue n’aime pas les enfants, dans les « Cahiers vaudois » en 1917, Le débourrage de crane est-il possible ?, en 1924. Il accompagne cette œuvre critique de manuels d’apprentissage des mathématiques et participe activement au Comité de direction de la « Ligue internationale pour l’Education rationnelle de l’Enfance », et à la création de l’Ecole Ferrer à Lausanne.
En parallèle avec cet engagement d’éducateur, son invention de Balthazar, riant de tout, semble correspondre à une nature réellement optimiste. Or il renonce à la vie en 1925, poussé par les dettes le désespoir et le désabusement, et il explique ce geste dans son texte, Mon suicide, publié en 1926. Cet acte, apparemment contradictoire avec son combat politique, social et pédagogique, amène à se demander si la problématique de la difficulté d’être, de la lutte pour continuer à vivre et du risque d’échouer dans ses espoirs, n’aurait pas toujours accompagné ses combats sociaux, pédagogiques et politiques. Roorda écrit, tenaillé par le doute, sur le sens de sa lutte. C’est un peu comme s’il était un révolutionnaire convaincu qu’un progrès de l’homme est possible, mais désespéré par l’impossibilité de résoudre les questions existentielles qu’il affronte. Ce hiatus rend sa pensée complexe et souvent paradoxale ; et son œuvre reste en tension entre les termes de cette contradiction à laquelle il ne trouve pas de réponse.
La composition et les chroniques rassemblées dans A prendre ou à laisser l’illustrent : Roorda commence son texte par une préface où il pose lui-même à Balthazar le dilemme suivant : « Tu ne sais même pas si le tien [ton livre] est sérieux ou pas », et lui répond : « Une telle question est insoluble » ; et il poursuit en énonçant les « deux conditions nécessaires et suffisantes » qui justifient le livre : « un auteur naïf, vaniteux ou cupide, et un éditeur confiant » (p. 9). Ironie du doute sur la capacité d’un livre à changer quelque chose dans le monde.
Quant au premier chapitre, il fait apparaître la raison existentielle qui contredit constamment l’espoir de pouvoir agir sur la condition humaine. « Attendre » fait un constat amer : y est peint un être humain en suspension d’action permanente, sans ennui, ni véritable espoir, « habitué » à la patience, défini par sa résignation à pouvoir se contenter du « vide de ses journées ». Or, Balthazar conclut qu’il ne peut ni s’apitoyer sur l’homme, ni l’aider : « Non, il valait mieux que sa pensée restât endormie » (p. 10). Seuls les « sages », eux, attendent « rien de plus que leurs petits plaisirs quotidiens » (p. 11).
Ce qu’il reprendra en écho par sa conclusion du dernier chapitre : « [Les gens] attendent, patients et confiants, le triomphe de la Justice. Moi aussi je l’attends ; je l’attends même depuis le jour lointain où j’ai reçu ma première fessée. Cela n’empêche que, quotidiennement, j’oublie mes rêves les plus généreux et me mets à songer avec mélancolie à des filets de sole, à des râbles durables ou à des perdreaux aux choux » (p. 229). S’il est vrai que « les plus belles pensées viennent du ventre » capable d’élaborer « le principe léger qui permet à mon âme de s’élever cinquante mètres au-dessus du sol » (p. 230), ces pensées sont peut-être seulement des modes de distraction du « souci de vivre » (p.202). Mais, à la différence de Pascal, la conscience du « divertissement » n’est pas une raison pour chercher un sens de la vie en Dieu. Au contraire, dans « Le mot de Cambronne », il attribue l’usage originel de ce vocable à l’humanité se séparant, après « deux mille ans » d’« Amen », de toute compensation transcendante à la difficulté de vivre : « L’apostrophe célèbre n’est pas celle d’un général français vaincu ; c’est la clameur de toute une race qui, depuis les temps de la Genèse, traîne sa misère sous l’indifférence des cieux » (p. 224).
L’image de la condition humaine ponctue le livre régulièrement : épreuve du passage du temps, dans « Le colleur d’affiche », p. 24-25, ambiguïtés du rapport à autrui, dans « Poignées de mains », p. 29-31, piètres satisfactions obtenues par les divertissements que s’accordent les humains. Par exemple, dans « Les fêtes et la joie » (p. 37-40), il ironise sur l’attrait des foules pour les fanfares et autres fêtes publiques en leur opposant les belles joies simples de « la jeune mère qui apprend à sourire à son enfant », etc. Mais cela suffit-il pour compenser la douleur humaine qui lui semble universelle, nécessaire et indéracinable ? Il avoue « : « On diffère moins des autres qu’on ne l’imagine. Moi aussi j’ai eu plaisir à passer dans des rues pavoisées » (p. 39). Alors oublier son sort par tous les moyens semble de mise, et le désespoir pointe sous son souhait contre « Le souci » : « Malgré tout, je voudrais que notre race connût une fois, avant la mort du soleil, l’insouciance et la sérénité » (p. 203).
C’est pourquoi tout en définissant Balthazar, comme « professeur d’optimisme » pour conseiller les gens déprimés, Roorda le fait néanmoins conclure sur son propre cas : « Je tiens à prendre des précautions pour que le bel optimisme de ma lointaine enfance - qui s’est si bien défendu ! - puisse résister encore quelques années à l’armée des invisibles rongeurs qui reviennent toujours l’assaillir » (p. 46). La désespérance n’est jamais très loin chez Roorda !
Que devient alors la révolte de l’enfant d’anarchiste ? Elle pointe, elle aussi, constamment, mais plutôt comme le contrepoint, non divertissant, d’un désespoir toujours renaissant. Roorda ne réduit pas ses revendications à la croyance univoque en un « demain on rase gratis », où l’Idéal viendrait s’incarner dans le monde.
C’est pourquoi Balthazar, commentant « Le mot de Cambronne », articule entre elles, comme les deux formes d’une même idée, les deux significations distinctes du vocable : la première, le mode majeur, violent, de « l’irrespect transcendantal » contre tout pouvoir, contre l’Etat, contre « le Représentant de l’Ordre universel, le hideux Fonctionnaire », contre « le Législateur » (p. 225-227). La seconde signification, « le mode mineur » est le « Cri » de l’humanité qui proteste contre « la griffe du Destin », contre « le Fait cosmique, brutal et nécessaire » sans aide d’un Dieu, et contre « le désenchantement des êtres à qui la vie a fait trop de promesses », comme la trahison : « lorsque, pénétrant inopinément dans notre chambre à coucher, nous apercevons notre fidèle Mélanie assise sur les genoux de l’Homme du Gaz ».
Mais, il fait apparaître que les deux acceptions se rejoignent dans le sentiment de joie de vivre à proférer le mot. Parodie, et, en même temps, réinterprétation du cogito : « l’Individu » s’affirme comme existence à ce moment où il prend la parole ; en effet il s’y pose lui-même pleinement comme consciente libre de toute attache, dépendance, soumission, face à ce qu’il rejette ou contre quoi il proteste : « Je dis : « ! » donc je suis » (p. 227).
Prééminence de l’individualité. Comme Stirner, Roorda affirme le caractère unique de chaque être. Mais il fait prendre à cet « égoïsme » un sens politique dans le chapitre « Proclamation aux électeurs intelligents ». Car, même si sa source est dans « la somme des embêtements et des douleurs que vous devez supporter », il n’en demeure pas moins qu’elle est à l’origine de la manipulation que font les hommes d’Etat : ils prétendent alléger, en la prenant en charge, cette condition humaine, en se faisant passer pour défenseur de « l’intérêt général ». « Citoyens, Qu’un homme d’Etat ne se soucie pas plus de nous que nous nous soucions de lui, c’est compréhensible. Ce qui est scandaleux, ce qui est intolérable, c’est que notre égoïsme soit moins légitime que le sien. […] J’affirme l’équivalence absolue de tous les égoïsmes » (p. 216). Personne d’autre que l’individu ne peut prendre en charge le souci de vivre. Il y a une solitude absolue de l’être, un délaissement ontologique qui donne au mot « égoïsme » une autre signification que celle qu’elle prend habituellement dans le bonheur des bourgeois.
Même l’amitié, l’amour et l’émerveillement surtout pour les enfants ne soulagent pas ; mais on peut y découvrir une relation à l’autre fondée sur le respect qui encourage l’espoir. Ainsi dans « Nos enfants » il critique la notion de « modèle » d’éducation et affirme : « Et voilà pourquoi je me dis quelquefois : Tant mieux ! lorsque je constate que mes enfants ne se conforment pas à mon « idéal » » (p. 71).
Au centre de sa réflexion réside donc le sens de sa revendication libertaire : ne vous soumettez à aucun père protecteur, l’Etat édicte des lois et prend des décisions qui oppriment les hommes sans se préoccuper de leurs intérêts propres. Il n’est qu’un instrument au service de la volonté de puissance des gouvernants. Il est vrai que la référence à la guerre permet à Roorda de mettre en évidence cette tromperie et l’exploitation de la crédulité des hommes qui la fonde : « Quand les monarques et les démagogues veulent utiliser le courage des êtres obscurs qui composent le peuple, ils leur disent : « Vous êtes des héros ». L’enrégimentement des hommes par les Allemands fait donc appel, dit-il dans « Le débochage de l’humanité », à la brutalité la plus primitive qui réside en eux. Il a eu lieu lorsque les êtres « se sont groupés en troupeaux immenses derrière un berger qui avait une « Idée » (p.80). Et le sacrifice des héros peut commencer si les hommes ont régressé jusqu’à « la bête qui est en nous » (p. 81).
L’idée de progrès apparaît en contrepoint de celle de régression. Si faire de la politique a un sens, c’est en permettant aux hommes de « vaincre la bête qui est en nous. Ce serait le vrai héroïsme » (p. 81). Or comment le réaliser ? Roorda n’appelle pas à la révolte de manière simpliste, au contraire il met en évidence, en particulier dans le chapitre « Vive la France » (p.106-109), toutes les difficultés qui viennent faire obstacle à l’accomplissement d’un monde « où l’homme n’aura plus peur de l’homme ». Il n’est pas hégélien ou marxiste, et n’inscrit pas l’idée de progrès dans la logique historique de l’Idée ou de la lutte des classes. S’il admet que la Révolution Française est un moment de progrès vers « l’instinct nouveau » d’une sociabilité fondée sur l’égalité des droits des individus, il ne l’attribue qu’au lent mûrissement des seuls Français vers « la possibilité de la Justice sociale ». Sans doute quelques-uns seulement ont su se faire entendre des autres. Mais un peuple éduqué est un ensemble d’individus « pour qui les autres hommes existent », et ils sont capables de sourire, thème récurent qui métaphorise chez Roorda cette sociabilité fondée sur la volonté ; et seulement là ils ont pu s’affranchir du « Respect » pour l’autorité des « habiles » et « parler au nom de l’Humanité entière ».
Mais ce caractère du Français, pensé comme « le bipède humain complètement redressé », a un caractère exceptionnel sans qu’aucune logique historique ne l’explique : Roorda réfléchit à partir du rapport entre nature et éducation et non de l’idée de sens de l’histoire. Seule l’éducation a permis aux Français ce progrès contre la primitivité ; seule une éducation digne de ce nom permettrait, malgré ses lenteurs, aux autres peuples d’accéder au même niveau de conscience. C’est pourquoi il accuse les Allemands d’avoir provoqué une régression des hommes, alors même qu’ils avaient acquis un certain « vernis » (p. 78) de sociabilité.
Or justement ce n’était qu’un vernis dû aux « mensonges dans l’éducation qu’on donne aux hommes ». La manipulation et la régression supposaient que « la boue de la terre » puisse être « remuée » (p. 80) et que l’éducation ne soit qu’apparence. Et la critique de l’Ecole, que fait Roorda, prend tout son sens même s’il l’a inaugurée avant la Grande Guerre. Son leitmotiv est que le danger majeur guettant les individus dans une société est la négation de leur liberté par leur intégration dans une masse impersonnelle.
Qu’est cette liberté qui fait l’essence de l’individu ? « Vous, mes enfants, vous voulez que mes paroles soient l’expression exacte de ce que je pense et que je sens aujourd’hui, en ce moment-ci. Vous avez raison. Nous voulons être des êtres vivants et non des machines ». Et il poursuit, dans le chapitre « Un sincère » (p. 141), en se référant à Bergson : la liberté est au cœur de l’être un mouvement de transformation permanent. « Ceux qui vivent […] se renouvellent sans cesse. » La liberté est le pouvoir de la spontanéité créatrice de chacun ; rien en lui et dans le monde ne reste stable. L’individu est cette puissance d’affronter le changement et de le vouloir comme son œuvre propre sans y être déterminé par une autre puissance que lui-même. Or l’Ecole éduque à l’inverse. Elle prépare la soumission des foules à l’Etat en uniformisant les savoirs, les référents, les comportements. Dépersonnalisation : l’école apprend aux hommes à renoncer à trouver par eux-mêmes la solution aux problèmes, mais à apprendre passivement la même réponse pour tous comme si une vérité pouvait exister. Et par conséquent tous ceux qui dirigent « pensent par idées toutes faites. Ils servent à la foule des formules auxquelles elle est habituée et qu’elle attend » (p. 141). La croyance en l’effet de vérité permet la manipulation.
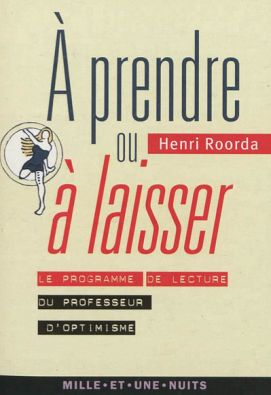 L’individu disparaît, alors il se confond avec les autres dans une masse qui a pris l’habitude de normes communes de vie et ne tolère pas les différences. « Nous voulons que l’individu reste « dans le rang », s’exclame Balthazar dans le chapitre « Notre volume » (p. 117). Dépossession de la liberté par la dépossession de la maîtrise de son temps, de ses pensées, de ses choix : « L’école a donc bien compris son rôle d’éducatrice, puisqu’elle habitue les enfants à supporter les heures vides qui, à peu de choses près, composeront leur existence », dit-il dans « Attendre » (p. 11).
L’individu disparaît, alors il se confond avec les autres dans une masse qui a pris l’habitude de normes communes de vie et ne tolère pas les différences. « Nous voulons que l’individu reste « dans le rang », s’exclame Balthazar dans le chapitre « Notre volume » (p. 117). Dépossession de la liberté par la dépossession de la maîtrise de son temps, de ses pensées, de ses choix : « L’école a donc bien compris son rôle d’éducatrice, puisqu’elle habitue les enfants à supporter les heures vides qui, à peu de choses près, composeront leur existence », dit-il dans « Attendre » (p. 11).
Roorda pédagogue insiste donc sur l’idée d’une autre école qui provoquerait la progression des hommes vers leur individualité, donc à une vie sociable où chacun tiendrait compte de l’autre. Que faut-il savoir, comment et en vue de quoi enseigner ? La question préalable est donc : que doit-il rester chez l’élève une fois qu’il est parti de l’école ? La réponse en particulier est celle que donnent « Le pédagogue facétieux » (p. 20 à 23) et « Le professeur d’optimisme » (p. 45) ; et elle est simple : « N’abusons pas de la règle de trois », c’est-à-dire ne mécanisons pas les formes de l’intelligence en apprenant « trop de mathématiques, trop de grammaire, trop d’histoire, trop de géographie » la quantité tue la qualité. Au contraire cultivons la liberté de l’esprit, le développement des « talents naissants » (p. 34), le sens de la qualité de la vie, et surtout la connaissance des valeurs fondatrices de la vie : « les bonheurs faciles », « la bienveillance », « les belles idées et les belles images » de la poésie en particulier, le sourire optimiste face à la vie et aux autres (p. 45-46). Ce qui suppose une pédagogie de la découverte de la qualité de la vie : rien qui soit utile en fait à la société normalisatrice, aux pouvoirs qui exploitent, aux inégalités dues à l’argent (p. 130-133), aux irrespects d’hommes qui ne pensent que par la valeur quantitative des êtres et des choses : « Les nombres » et « Encore les nombres » (p. 94-99).
Or, pour atteindre son but, Roorda fait rire. Mais son humour est complexe. Il est vrai qu’il emploie tous les procédés pour provoquer le rire : l’ironie, l’exagération, le pied de la lettre, la provocation, mais aussi le jeu de mots, les calembours même, l’absurde dans « Le scandale des tramways lausannois » (p. 81-84), etc. On aurait vite fait de l’accuser de légèreté ; cela ne vaudrait que si le rire, pour lui, n’était que rire sociable et donc partage des mêmes connivences. Or son rire est d’abord dévastateur : aucune valeur ne résiste à ses atteintes : il y a du Nietzsche chez Roorda. Mais sa cruauté s’arrête face à la considération de notre condition tragique, parce que, fondamentalement, ce qui est risible est la dérision de nos stratagèmes pour nous la cacher ; il les passe donc en revue pour mieux nous les faire comprendre : recherche de sécurité, peur des autres, ambivalence des amitiés, tendance à vouloir imposer son pouvoir, en particulier sur les femmes et les enfants, mesquineries, plaisirs légers, etc. Mais il montre aussi, en tant que penseur politique, que même si les Etats exploitent cette fragilité et que l’Ecole neutralise la liberté, l’homme peut progresser. Par cela son rire reste humaniste, donc optimiste.
Cette tension, entre ce que l’individu doit supporter nécessairement et ce qu’il peut espérer atteindre comme sociabilité et justice n’a pas de solution définitive : elle reste un équilibre précaire. Jamais on n’annulera la solitude fondamentale, et donc l’être humain tient le coup en espérant. L’avenir des hommes dépend alors de cet espoir pour que quelque chose advienne. Ainsi Balthazar évoque la lourdeur de ceux qui veulent toujours empêcher les autres de se suicider : « Les sauveurs ». Mais chacun doit être juge répond-il. La volonté de résister ou pas est propre à l’individu : « Que les moralistes-repêcheurs sachent qu’à mon âge on ne se tue pas pour des enfantillages. Pendant plusieurs semaines, j’ai essayé de regarder l’avenir avec espoir ; mais cela ne durait pas. Un de mes ressorts essentiels était cassé » (p. 57). C’est donc à partir de la solitude que naît l’avenir de tous, avec ces déclencheurs de liberté et d’éducation que sont les grands individus : « Puisse-t-il y avoir toujours des Individus, des Egoïstes, aimant la solitude ! » s’exclame Balthazar dans « Une nouvelle ligue ». Et prenant les exemples de Jeanne d’Arc et de Beethoven, il poursuit : Les grands penseurs, les grands artistes, et les saints qui ont versé dans l’Ame humaine le trésor de leur âme unique étaient seuls au moment où ils ont pensé, ou agi » (p. 27).
On comprend mieux ainsi les interrogations liminaires de la préface d’A prendre ou à laisser ; elles indiquent sans doute la retenue de Roorda face à la valeur éducatrice de son œuvre. La publication de ses chroniques permet la découverte d’une philosophie toute en nuances. Or tout en comprenant la fragilité de l’individu, il tente de lui redonner la force de l’espoir en provoquant son rire. Il veut qu’elle soit un optimisme, désespéré sans doute, mais un optimisme quand même !
Michel Cardin