Célia Sauvage, Critiquer Quentin Tarantino est-il raisonnable ?, Vrin, 2013, lu par Nazim Siblot
Par Cyril Morana le 14 mai 2013, 05:28 - Esthétique - Lien permanent
 Célia Sauvage, Critiquer
Quentin Tarantino est-il raisonnable ?, Vrin, « Philosophie et
cinéma », 2013.
Célia Sauvage, Critiquer
Quentin Tarantino est-il raisonnable ?, Vrin, « Philosophie et
cinéma », 2013.
C’est
non seulement les films, mais encore l’ensemble discursif constitué des propos
de Tarantino et de leur réception, qu’interroge Célia Sauvage, afin de de
dégager les clés d’interprétation d’une démarche marquée par sa profonde
ambiguïté. Au lieu de se cantonner au niveau esthétique, Critiquer Quentin Tarantino est-il raisonnable ? prend ainsi le
parti d’une analyse globale de la « stratégie réflexive » du
cinéaste.
Rare exemple de cinéaste alliant succès populaire et reconnaissance critique, Quentin Tarantino suscite depuis ses premiers films des réactions contrastées, voire polémiques[1], entre adulation et dénigrement. Or ces réactions contradictoires, souvent virulentes et dépassant le cadre de la critique cinématographique, peuvent largement être imputées au personnage public que s’est construit le réalisateur. C’est donc non seulement les films, mais encore l’ensemble discursif constitué des propos de Tarantino et de leur réception, qu’interroge Célia Sauvage, afin de de dégager les clés d’interprétation d’une démarche marquée par sa profonde ambiguïté. Au lieu de se cantonner au niveau esthétique, Critiquer Quentin Tarantino est-il raisonnable ? prend ainsi le parti d’une analyse globale de la « stratégie réflexive » du cinéaste.
Le premier chapitre (« Tarantino est-il trop cinéphile pour faire de bons films ? ») aborde l’image de cinéphile passionné que le réalisateur entend donner de lui-même. En effet, s’il se livre très peu sur sa vie privée, Tarantino est prolixe sur sa vision du cinéma et sa démarche de cinéaste. Assumant totalement, en post-moderne, de s’inscrire dans un réseau intertextuel au lieu de prétendre révolutionner son art (« Je vole des idées dans tous les films qui existent », dit-il), Tarantino multiplie les allusions et références, aussi bien dans ses entretiens que dans ses films. Cette « logique d’accumulation d’un savoir illimité », accompagné du désir de partager sa passion, participe sans doute au regard bienveillant porté par une partie de la critique sur cet ancien loueur de VHS devenu un pilier d’Hollywood. Tarantino, qui a fondé un festival et détient une salle de cinéma où il projette ses films favoris et en débat, s’inscrit ainsi dans une « logique muséale » visant à diffuser des œuvres méconnues. C. Sauvage parle pourtant d’« auteurisme problématique », pour deux raisons principales. Tout d’abord, cette cinéphilie boulimique, assumant un « subjectivisme radical » et rejetant toute hiérarchie des genres, risque de diluer toute notion de qualité dans un relativisme où se côtoient chef-d’œuvres et séries B (voire Z). Ensuite se pose la question, particulièrement épineuse, de l’imitation (voire du « plagiat pur et simple ») : comment revendiquer la posture du créateur original lorsque l’on reprend à la virgule près certaines tirades, voire qu’on duplique intégralement le scénario[2] d’autres films ?
Dans le deuxième chapitre (« Les films de Tarantino sont-ils trop bavards pour avoir quelque chose à dire ? »), l’analyse cible les procédés d’écriture et la construction d’une dramaturgie, véritable monde parallèle, par le réalisateur. Tenté d’abord par une vocation d’écrivain, Tarantino soigne particulièrement les dialogues de ses films, truffés de digressions sans rapport avec l’action, ainsi reléguée au second plan par cette prolifération verbale. Mais on lui reproche que ces tirades, certes ludiques et rythmées, soient gratuites et futiles, signant selon un critique « la victoire du style sur la substance ». Cet usage formel de la parole révèle pourtant le pouvoir auto-référentiel du langage : le récit n’est au fond qu’un prétexte à des monologues qui ne renvoient pas à une signification extérieure mais sont à eux-mêmes leur propre fin. Tel un romancier, le cinéaste se pose également « comme un créateur d’univers possédant la pleine maîtrise de ses personnages » : dans une sorte de Comédie humaine dopée à l’hémoglobine, il construit un réseau où les personnages se croisent, s’éclipsent pour mieux réapparaître, au sein de narrations complexes, non linéaires, qui illustrent dans une succession de récits un « perspectivisme radical ». Jouant avec le hors-champ, Tarantino suggère ainsi l’épaisseur d’un univers imaginaire où les personnages, même secondaires, ont chacun leur vie propre, une trajectoire antérieure et à venir qui pourrait donner indéfiniment matière à de nouveaux films. Cette suggestion d’un univers non dévoilé et de questions laissées sans réponses, s’apparente à un procédé déceptif volontaire, qui maintient en suspens l’attente du spectateur, et, en ouvrant l’interprétation, crée un effet de distanciation.
Le
troisième chapitre (« Tarantino, le mythe et ses films. ») est
consacré à la manière dont, au fil des réceptions successives de ses films (une
vingtaine d’ouvrages lui ont déjà été consacrés), le cinéaste entend orienter
l’appréciation de son œuvre, et prendre à sa charge « la création de son
propre mythe ». Ce désir de reconnaissance est d’abord mis en abyme par
certains personnages, précédés d’une réputation légendaire. Par ailleurs,
Tarantino, lui-même acteur dans des seconds rôles, joue ironiquement de son
personnage public de « cinéphile, geek
et obsédé » à travers nombre de ses apparitions – dans ses propres films ou ceux de réalisateurs
qui s’inscrivent dans sa mouvance, et qu’il produit souvent. Ceci participe
d’une volonté délibérée « de dépasser le cadre de son œuvre pour organiser
l’héritage de son cinéma », et confirme que le succès de Tarantino tient
aussi à une image habilement construite.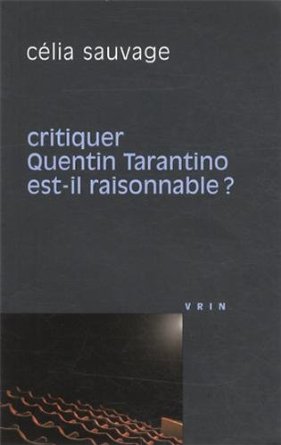
Le quatrième et dernier chapitre (« Les films de Tarantino sont-ils misogynes et racistes ? ») montre, au-delà de celui de construire sa propre légende, le « désir de retravailler, voire de déconstruire les mythes américains ». Malgré son refus ostensible de tout engagement politique, le réalisateur porte ainsi un regard sur sa société et les archétypes qui la structurent. Les figures de l’autorité paternelle tout d’abord sont régulièrement tournées en ridicule ou rabaissées. La valorisation de personnages féminins forts et actifs, capables des mêmes exploits que les héros masculins habituels des films d’action, a aussi valu à Tarantino « la réputation de cinéaste proche de la cause féministe ». Enfin nombre de ses films révèlent une fascination pour la culture afro-américaine, et donnent le premier rôle à des personnages Noirs, les faisant ainsi sortir de leur position classique de simples acolytes du héros. L’ambiguïté de la démarche de Tarantino ressort pourtant une fois de plus : porte-t-il vraiment un discours critique, subversif, ou ne reprend-il pas finalement à son compte les clichés qu’il prétend mettre à distance ? Par exemple la Mariée, dans Kill Bill, triomphe de ses adversaires, mais en endossant l’ultra-violence du héros viril traditionnel, et dans le seul but de remplir sa fonction maternelle, la fin du film marquant le retour à l’ordre « naturel » des choses. Incarnations du détachement et de la cool attitude, les Afro-américains n’en restent pas moins, dans Pulp Fiction ou Jackie Brown, des criminels ou des dealers qui ne cessent de s’interpeler par des « nigger » retentissants. Cette relation fantasmée à l’image des Noirs-américains, déconnectée de tout contexte social pour n’en retenir que le folklore superficiel, a été reprochée au réalisateur. L’alibi déconstructionniste ne ferait alors que masquer un stratagème classique de publicité par le scandale et l’érotisation de la violence.
L’originalité de la démarche de C. Sauvage mérite d’être soulignée : ni théorie de l’art, ni monographie sociologique, le propos relève plutôt de l’esthétique de la réception. Nous sommes ainsi amenés à réfléchir sur nos propres représentations de l’art et des artistes, et nos attentes, parfois contradictoires, vis-à-vis d’eux.
L’ambiguïté de la position de Tarantino, maître du double-discours, est plus largement symptomatique de celle des artistes contemporains, qui cherchent à s’affranchir des oppositions, devenues traditionnelles depuis Kant, définissant l’attitude artistique « pure ».
En prétendant être un auteur tout en se situant au cœur de l’industrie cinématographique, c’est le fossé entre l’art et le métier, l’esthétique et le « commercial », qui est enjambé. Entre élitisme et divertissement, la prétention à faire une œuvre tout en théorisant le « cinéma parc d’attractions », simple support à sensation, dynamite la distinction entre le beau et l’agréable. Enfin, en voulant à la fois donner du contenu, apparaître comme transgressif, et en se posant en parallèle comme totalement désengagé, dans une sorte d’ art pour l’art pop, Tarantino cherche à court-circuiter l’opposition entre fond et forme, message et esthétique.
Peu soucieux de cohérence interne, le discours des artistes sur leur démarche ne doit donc pas être lu comme la théorie qu’il prétend parfois être, mais bien comme une stratégie, qui, dans le cas de Tarantino, entend cumuler tous les profits – aussi bien symboliques que matériels. Toute l’efficacité de ce dernier est d’empêcher purement et simplement l’expression d’un point de vue extérieur ! Parachevant le processus d’autonomisation de l’art décrit par Bourdieu, Tarantino revendique en effet « le monopole de l’interprétation » de ses films, et rend la critique impossible, en se situant à la fois du côté des arts d’agréments et des beaux-arts, du divertissement et de la réflexion. Stratégie qui, malgré le « risque d’être superficiel sur les deux niveaux d’intention », s’est avérée efficace, mais dont on comprend qu’elle puisse à la fois fasciner et indigner.
Nazim SIBLOT
[1] Django Unchained (2012), sorti après la publication de l’ouvrage, perpétue cette tendance (le film a été censuré en Chine quelques heures à peine après sa sortie), et confirme notamment les analyses du chapitre 4 sur le rapport ambigu du réalisateur aux Afro-américains.
[2] Reservoir Dogs (1992), premier film de Q. Tarantino, reprend très exactement le récit, et même de nombreux plans, d’un film policier hong-kongais (City on Fire, Ringo Lam, 1987).