É. Akamatsu, É. Oudin, M. Perruche, Le plaisir, de Platon à Onfray, éditions Eyrolles, lu par Aline Beilin
Par Michel Cardin le 12 novembre 2013, 06:05 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
 Étienne Akamatsu, Éric Oudin, Mariane Perruche, Le plaisir, de Platon à Onfray, éditions Eyrolles, Collection Petite philosophie des grandes idées, Paris, avril 2013.
Étienne Akamatsu, Éric Oudin, Mariane Perruche, Le plaisir, de Platon à Onfray, éditions Eyrolles, Collection Petite philosophie des grandes idées, Paris, avril 2013.
La collection « Petite philosophie des grandes idées » se propose de redonner des éléments de l’histoire d’un concept à travers une dizaine de penseurs. André Comte-Sponville confirme en préface l’intérêt d’une telle recension sur la notion de plaisir.
Car si le plaisir est de l’ordre de l’évidence, en tant qu’expérience et donnée anthropologique, il mérite d’être pensé philosophiquement. Les questions de la nature et de la valeur morale, ou bien celle de la hiérarchie des plaisirs, ne sont pas aisées, par exemple. André Comte-Sponville justifie enfin le choix, sans aucun doute difficile à opérer, des doctrines abordées dans l’ouvrage : si certains philosophes choisis par les auteurs peuvent appartenir à la tradition, ils ne seront pas abordés de manière classique ; d’autres sont moins connus ou moins lus - on pense à La Mettrie, Bentham, voire Sade - et la compréhension de la notion, centrale dans leur philosophie, s’enrichit de leur lecture.
Le premier chapitre est titré « Platon ou la place du plaisir ». Il faut se garder, rappellent les auteurs, de lire les textes du fondateur de l’Académie à la lumière de leur reprise chrétienne : sa doctrine du plaisir ne saurait être réduite à une simple condamnation des plaisirs. On sait que Socrate a condamné la vie de l’homme déréglé. Cependant ni la sagesse ni le plaisir ne se suffisent à eux-mêmes et ne se confondent avec le Bien. La vie bonne résulte d’un mixte de sagesse et de plaisirs. Il s’agit là des plaisirs purs. Les auteurs rappellent ici que la distinction des plaisirs purs et impurs (ou serviles) ne recouvre pas celle des plaisirs de l’intellect et des plaisirs sensibles. Certains plaisirs qui sont de l’âme seule sont des plaisirs mélangés ; il en va ainsi du plaisir éprouvé au spectacle de la comédie ou de la tragédie. Que sont, au fond, les plaisirs impurs ? Ce sont les faux-plaisirs, les plaisirs illusoires et trompeurs. Par là, le lecteur de Platon est reconduit à la question fondamentale, celle de la vérité, car seuls les plaisirs purs sont vrais.
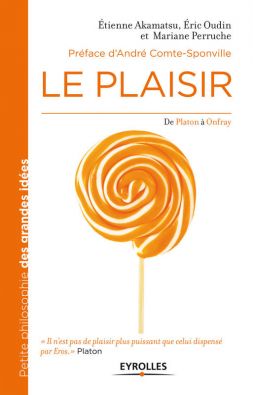 Le second chapitre s’intitule « Aristote ou le
plaisir achevé ». La théorie du plaisir du stagirite est assez connue. Il
ne faut pas rechercher les plaisirs de manière intempérante. Une vie
prudente n’est pas dépourvue de plaisirs pour autant, en premier lieu des
plaisirs de l’âme, mais aussi de ceux du corps. Les plaisirs les plus élevés
sont ceux de la contemplation, du pur et simple loisir : dans une
téléologie, chaque espèce est susceptible d’un plaisir propre, et la
spécificité de l’espèce humaine en la matière réside dans la vie rationnelle de
l’âme. Reste que le plaisir est parachèvement de l’acte : il suit
l’exercice de la vertu, car seule la vertu peut donner à la vie la perfection,
l’excellence qu’elle doit avoir pour être dite heureuse.
Le second chapitre s’intitule « Aristote ou le
plaisir achevé ». La théorie du plaisir du stagirite est assez connue. Il
ne faut pas rechercher les plaisirs de manière intempérante. Une vie
prudente n’est pas dépourvue de plaisirs pour autant, en premier lieu des
plaisirs de l’âme, mais aussi de ceux du corps. Les plaisirs les plus élevés
sont ceux de la contemplation, du pur et simple loisir : dans une
téléologie, chaque espèce est susceptible d’un plaisir propre, et la
spécificité de l’espèce humaine en la matière réside dans la vie rationnelle de
l’âme. Reste que le plaisir est parachèvement de l’acte : il suit
l’exercice de la vertu, car seule la vertu peut donner à la vie la perfection,
l’excellence qu’elle doit avoir pour être dite heureuse.
Le troisième chapitre, « Aristippe et Epicure, ou le plaisir comme philosophie », traite de deux philosophies qui ont le plaisir pour principe. Aborder ensemble Aristippe et Epicure suppose d’envisager à la fois ce qu’ils partagent et ce qui les distingue. Tous deux posent le plaisir comme le souverain bien, ainsi que le désigne la nature. Les plaisirs sont la fin ultime qu’il faut atteindre, mais être sage, c’est posséder le plaisir et ne pas être possédé par lui. Ils diffèrent en ce que, pour les Cyrénaïques, le plaisir est en mouvement et n’existe qu’au présent : tous les plaisirs se valent et sont bons à prendre, sans fausse honte. Epicure, quant à lui, adopte une définition négative du plaisir au repos, comme absence de souffrance. Une arithmétique des plaisirs est alors nécessaire pour se déterminer face au désir. C’est cette arithmétique qui, selon les auteurs, met l’épicurisme à égale distance d’un hédonisme irréfléchi et d’un ascétisme sans nuance, rendant l’interprétation parfois difficile.
Dans le chapitre consacré à la philosophie thomiste, « Thomas d’Aquin ou le plaisir comme péché capital », les auteurs invitent à distinguer l’héritage aristotélicien et ce qui s’en déprend. Ainsi, si la quête du bonheur est naturelle et universelle, si l’homme a un désir de béatitude, ici il ne peut atteindre cet état qu’en s’exerçant aux prescriptions de la Révélation et ne désirer que les biens qui s’accordent avec la raison ; les plaisirs du corps sont une « ligature » de la raison. Si, ici, le plaisir peut être le signe de la bonté des choses comme chez Aristote, c’est en tant qu’elle renvoie elle-même à la bonté infinie de Dieu et les biens terrestres ne doivent être considérés que comme des moyens et des ressources pour se tourner vers Dieu.
Le chapitre cinquième, « La Mettrie ou l’art de jouir », est consacré à un libertin érudit qui choisit la volupté contre la débauche. La Mettrie est matérialiste, d’un matérialisme que les auteurs considèrent comme limité. Le plaisir doit être pensé à partir des concepts de fonctionnement, de transport, d’organes. Pour autant la philosophie de La Mettrie ne se réduit pas à une physiologie : il établit la moralité sur la vie naturelle, la moralité d’un plaisir qui n’est jamais dans la démesure : l’homme heureux est un esprit libre, sans préjugé, dans un corps sain. L’enthousiasme de La Mettrie pour la volupté et le plaisir se prolongerait ici en une forme de religion du plaisir.
Le chapitre sixième s’intitule « Sade, ou le plaisir dans le crime ». La vie de Sade, libertin de mœurs, a été marquée par le crime et la douleur plus que par le plaisir. Il n’en demeure pas moins que ses romans érotiques contiennent des moments de philosophie libérée de la morale du grand siècle, des préjugés et de la morale religieuse. Pour Sade, le plaisir ne se vit que dans la saturation, et l’orgie est le symbole de cette démesure. Les plaisirs de la table se mêlent à ceux du sexe, ceux du blasphème au vol et à la violence des corps. Il faut être éduqué au plaisir, et cette éducation suit une gradation qui va des crimes mineurs - le sacrilège ou l’athéisme - aux « crimes moraux » (la prostitution, l’inceste ou le viol par exemple). L’homme est reconduit de plaisirs en plaisirs jusqu’au crime. Le plaisir déborde tout, dans une énergie et une débauche que rien n’arrête, et surtout pas la souffrance de l’autre.
Dans le chapitre consacré à Kant, les auteurs démontrent que le plaisir est une notion centrale de l’esthétique et de l’anthropologie, mais est exclue de la sphère de la moralité. D’un point de vue anthropologique, c’est même la douleur qui est première : ressentir sa vie et éprouver du contentement, c’est se sentir poussé à sortir de l’état de douleur. De même que, sans une occupation pénible, le loisir n’aurait pas de sens, sans la douleur le contentement ne saurait exister. C’est ici entre plaisir et devoir qu’il faut choisir et non entre plaisirs sensuels et plaisirs intellectuels. Le plaisir d’un point de vue pragmatique ne doit pas être confondu avec le point de vue pratique : donnée anthropologique, il n’a pas place dans une morale qui précisément doit être épurée de tout élément empirique. C’est dans l’esthétique que la notion devient, selon les auteurs, le lieu de paradoxes. D’une part, parce que le jugement de goût est subjectif mais prétend à l’universalité. D’autre part, parce que ce qui agrée est la source d’une sensation, tandis que le plaisir esthétique est sensible mais non sensuel puisqu’il est contemplatif. Si l’on pousse le rigorisme jusqu’au bout, le pur jugement de goût affirmerait la beauté d’une représentation jugée désagréable par les sens... Ceci dit, le formalisme de Kant le sauverait de son rigorisme : le beau peut ne pas être désagréable, il suffit qu’il ne soit pas agréable.
Le huitième chapitre s’intitule « Bentham ou le plaisir utile ». Les auteurs rappellent les fondements de l’utilitarisme : l’homme doit suivre la nature, qui a placé l’humanité sous le gouvernement de la douleur et du plaisir, ; une bonne action, utile, est une action qui procure le maximum de plaisir au plus grand nombre. De là la nécessité de ne pas errer dans l’arithmétique des plaisirs. La conviction de Bentham est que, si conflit de l’intérêt ou du devoir il y a, le devoir cédera toujours le pas à l’intérêt. Pour autant, il y a, plus souvent qu’on ne le croit, coïncidence de l’un et de l’autre. Par exemple, Bentham peut à la fois défendre la plus grande liberté sexuelle et la vertu de la chasteté, parce qu’elles augmentent la jouissance de l’individu. L’intérêt bien compris ne suffit pourtant pas à la moralité. De ce fait, le lecteur est reconduit à la question des rapports de la morale et du politique. La sanction publique et la sanction légale interviennent lorsque la morale échoue. Une telle pensée a le mérite notamment de dépasser les difficultés inhérentes à l’opposition de l’égoïsme et de l’altruisme, de s’attacher à une bonne connaissance des plaisirs (des sources et des facteurs qui font varier entre eux les plaisirs).
Titré « Freud ou sortir de l’éthique ? », le neuvième chapitre s’interroge sur les liens entre une approche économique voire mécaniste du plaisir, conçu sur un plan physiologique et psychique à la fois, et la morale ou l’éthique. Peut-on parler d’une éthique dans une théorie qui est, in fine, scientifique ? Cela conduit les auteurs à redessiner la place du plaisir ici. Freud ne fut pas hédoniste, ni dans sa vie ni dans sa doctrine : le plaisir n’est pas la fin, il ne trouve sa place que dans un processus économique permettant d’expliquer le fonctionnement de l’appareil psychique. Les auteurs accordent une place importe à la refonte de la représentation du psychisme après 1920, à savoir la place centrale accordée à la pulsion de mort. De plus, le plaisir comporte en lui-même un risque de mise en danger de l’identité. Si le plaisir est réhabilité par Freud, c’est en tant qu’il est activé par des processus sublimatoires, comme dans le plaisir esthétique. Ce chapitre tente donc de démontrer que la théorie freudienne est un renoncement à l’éthique, qui reconduit vers une éthique de la psychanalyse.
Le dernier chapitre, « Onfray ou le nouvel hédonisme » est consacré à l’auteur de la contre-histoire de la philosophie. Les auteurs redonnent ici le parti-pris d’une telle contre-histoire. Contre le nihilisme de la chair dans l’ascétisme (dans sa forme chrétienne essentiellement), puis dans le consumérisme libéral, Onfray entend donner à lire les Cyrénaïques, l’atomisme, l’épicurisme, les libertins, les socialistes ou les libertaires, qui conduisent à l’hédonisme moderne. Celui-ci met en avant le parti pris du corps, du plaisir libérateur, gratuit, exaltant, partageable et naturel, dans la gastronomie par exemple. Mais le plaisir ignorant de la douleur est stupide, car la souffrance relève aussi de l’expérience vitale : l’algodicée - la traversée de la douleur - met chacun, dans sa singularité, de plain pied avec l’existence. Reste que la philosophie est d’abord, comme l’écrivit Spinoza, une méditation de la vie et non de la mort.
Un tel ouvrage apparaît évidemment fort utile aux enseignants : il permet de clarifier les théories du plaisir de quelques auteurs majeurs. Toutefois, les chapitres sont inégaux, tant dans la clarté de l’exposition que dans la construction, ou encore dans le choix des textes et références contemporaines insérés dans les exposés sur les auteurs. Le choix des auteurs séduit davantage : il relève en effet autant de l’histoire de la philosophie en son sens le plus traditionnel que de la contre-histoire construite par Michel Onfray. Donner envie de relire Aristippe (via Diogène Laërce), Bentham ou Sade est à lui seul convaincant.
Aline Beilin