Jacques Ricot, Du bon usage de la compassion, PUF, 2013 lu par Nathalie Godefroid
Par Romain Couderc le 12 juin 2013, 06:00 - Éthique - Lien permanent
 Jacques Ricot, Du bon usage de la compassion, PUF, Care Studies, 2013.
Jacques Ricot, Du bon usage de la compassion, PUF, Care Studies, 2013.
Jacques Ricot, chargé de cours en bioéthique, travaille pour la SFAP, la « société française d'accompagnement et de soins palliatifs », et a publié plusieurs ouvrages sur la fin de vie. Son domaine d’étude est donc centré sur le rapport à autrui, en particulier quand celui-ci est en position de faiblesse et qu’il réclame notre aide et notre compassion.
Du bon usage de la compassion, Jacques Ricot entend définir ce que révèle l’expérience du pâtir propre à la compassion et se demande si on peut parler d'une bonne et d'une mauvaise compassion.
Jacques Ricot souligne d’emblée le mérite des éthiques du care qui permettent de reposer la question de l’articulation entre le sensible et le rationnel en s’opposant à des morales trop rigides et impersonnelles, et en réhabilitant une vie morale pratique au lieu de l’application de grands principes désincarnés. La réflexion sur les besoins des personnes fragiles ou dépendantes permet ainsi de fonder la morale sur la vulnérabilité.
Plan de
l'ouvrage :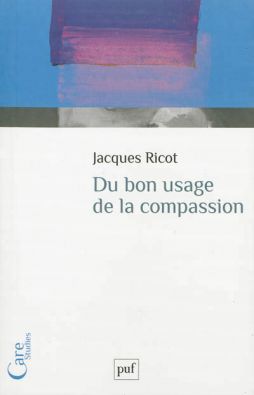
a) L’émotion que nous sentons devant la misère des autres
L’auteur débute son ouvrage par une étude du vocabulaire de la compassion, dont il tire les définitions nécessaires à son analyse, ainsi que différentes nuances qui en soulignent la complexité.
La définition de départ sera trouvée chez Smith, dans la Théorie des sentiments moraux : « la pitié ou la compassion, c’est-à-dire l’émotion que nous sentons pour la misère des autres ».
Que tirer de cette définition ?
- Qu'il ne faut pas se méprendre sur la notion de « pitié ». Le terme est aujourd’hui proche de « condescendance ». Pourtant la pitié, chez Rousseau et encore aujourd’hui, désigne la communication de personne à personne, le partage de la souffrance.
- Que la compassion est une émotion, motrice en tant que telle. Cependant, elle peut être stérile (quand on reste à distance d’autrui). Cet affect n’est pas une déficience puisqu'il permet de réintégrer l’homme dans le monde du vivant vulnérable.
- Que l'on compatit à la « misère » : la « passion » est quelque chose de subi, c’est le sentiment d’une épreuve endurée par autrui et qui m’affecte (les termes de « commisération », « miséricorde » rappelant ce lien à la misère).
- Que c’est la misère des « autres » qui la cause, d’où le préfixe « cum » (cf « commisération », « sympathie »). La compassion vise une forme d’ « altruisme » : c’est une disposition à sortir de soi et à s’intéresser aux autres.
b) Compatir, c’est pâtir
L’étymologie de la compassion nous ramène à la « passion » : l’homme, incarné, est sujet à la passion (alors que Dieu est « impassible »). La « passibilité » est donc proprement humaine : c’est la perméabilité aux êtres et aux choses, antérieure à toute réflexion, la disposition à être touché, comme par surprise, avant même de pouvoir dire « je ».
D’où une première définition de la compassion : « la compassion est une expérience particulière du pâtir, celle qui reçoit en partage la souffrance d’autrui et ce pâtir, loin d’être une pure réceptivité passive, est disponibilité active au monde, à autrui » (p. 19).
Ainsi chez Rousseau, la pitié est non réfléchie, c’est un sentiment naturel qui nous met en communication directe avec la souffrance d’autrui et cette communication est une communion, car c’est par identification et non par fusion que s’analyse la compassion : la souffrance d’autrui n’est pas la mienne, on partage la souffrance, mais on n’en prend pas une part, on se la représente seulement par l’imagination.
J. Ricot complète alors sa définition : « La compassion est cette sensibilité désarmante devant l’irruption en moi de la douleur d’autrui, non que cette douleur soit ressentie comme telle dans une impossible coïncidence, mais ce qui fait irruption est le sentiment d’une tristesse causée par la souffrance d’autrui » (p. 23).
Se pose alors un problème : comment la souffrance d’un autre peut-elle se rapporter à soi ? Réponse de Rousseau : par amour de soi. La compassion ne serait-elle qu’un égoïsme déguisé ? Mais l’amour de soi n’est pas l’égoïsme. Ce qui m’atteint chez celui qui souffre, c’est sa vulnérabilité, je reconnais ma vulnérabilité dans la sienne. Pour ne pas souffrir de la souffrance de l’autre, il faut la comparaison et la reconnaissance de ma supériorité, le refus d’assumer notre commune humanité.
Est-ce seulement en tant qu’humain que cette situation est expérimentée, ou en tant que vivants dotés d’une sensibilité ? C’est notre rapport aux animaux qui est alors interrogé. Chez Rousseau, l’animal est objet de pitié parce que c’est un être sensible, il a le droit à notre compassion. Rousseau contourne ainsi la définition classique de l’homme : ce qui le distingue de l’animal n’est pas la raison mais la liberté et la perfectibilité. C’est cette compassion envers les animaux que l’on retrouvera chez Bentham et Singer, chez qui est aboli le caractère exceptionnel de l'humanité.
Sans aller jusque là, on peut dire avec Kant que l’animal a le droit à notre protection, car notre cruauté à son égard est le signe de notre cruauté généralisée. Seul l’homme est un sujet imputable, mais on peut donner à l’animal le statut de sujet non imputable.
c) La compassion, un sentiment moral et rationnel
Il faut maintenant penser le rapport entre compassion et responsabilité morale. La compassion est-elle une disposition qui ouvre à la vie bonne ? La tradition philosophique n’est pas unanime : les morales rationnelles la discréditent, au contraire des morales du sentiment. Comment allier les deux pour faire un « bon usage » de la compassion ?
L’auteur passe alors en revue les théories qui ont abordé ce problème.
La philosophie écossaise du 18e siècle a développé une théorie du sentiment moral : il existe un « sens moral » indépendant de la raison, cependant il est limité aux proches, c’est pourquoi la justice doit y suppléer.
Rousseau est-il un représentant de ces morales du sentiment ? On pourrait le penser quand il loue la pitié, mais la raison n’est pas condamnée, elle est juste moins efficace pour l’acquisition des vertus.
Schopenhauer donne à la pitié une dimension métaphysique : c’est par elle qu’on prend conscience de l’unité des êtres de la nature, qui manifeste l’unique volonté. C’est le seul fondement possible à la morale, mais la perspective est la fusion dans le grand tout.
Il y a d’autre part les condamnations de la pitié dont la plus radicale est celle de Nietzsche, mais sa critique emporte toute morale. Le refus de la souffrance est à la fois refus de la vie et complaisance suspecte à jouir de la souffrance d’autrui, ce qui est humiliant et impudique à l’égard du souffrant qu’on réduit à sa souffrance et qu’on condamne à la honte. Il y oppose la pitié des forts, celle qui regarde la souffrance en face, parce qu’elle est une intensification de la vie.
Enfin, les morales rationnelles sont hostiles à l’entrée de la compassion dans la vie morale : pour les stoïciens, les passions troublent l’impassibilité du sage, le libre exercice de sa raison. Cicéron le résume : « plutôt que de plaindre les gens, pourquoi ne pas les secourir, si on peut ».
Chez Spinoza la compassion est une tristesse, donc inutile, et l’on connaît les analyses de Kant pour qui le sentiment, et la pitié en particulier, ne peuvent être des fondements stables pour la morale.
Conclusion :
On ne peut cependant pas renoncer à la compassion dans la vie morale. Le risque, c’est de ne connaître que la rigueur de la loi et de ses principes mécaniquement appliqués. On peut alors garder de Nietzsche l’idée d’une pitié des forts, sans sentimentalisme, et orientée vers l’action, vers le soin. Car une compassion sans action serait pire que l’indifférence : elle serait humiliante et honteuse. Certes, comme le dit Kant, la compassion, si elle n’est pas éclairée par la raison, peut être plus désastreuse que l’indifférence. Il y a une exigence d’universalité sans laquelle la vie morale est une casuistique intuitive et subjectiviste. Mais comme l’affirme Ricoeur, les sentiments moraux peuvent être des mobiles rationnels, car c’est toujours à des situations particulières que nous avons affaire.
Aujourd’hui, nous vivons dans une société de l’homme compassionnel, mais si la suppression (et non le soulagement) de la souffrance devient la nouvelle norme universelle, alors il faudra répondre à toute détresse, perçue comme une injustice devant un désir non réalisé (ce qu’on voit à l’œuvre dans le désir d’enfant, ou dans l’homicide compassionnel qui affaiblit dangereusement l’interdit du meurtre). La compassion n’est donc pas suffisante pour nous déterminer à bien agir. Pourtant, la compassion est « ce sans quoi aucune vie morale ne serait possible », elle est le moteur, l’ébranlement qui, éclairé par l’intelligence, nous maintient dans l’humanité.
Dans ce petit ouvrage (il ne fait que 50 pages), Jacques Ricot fait le point sur une notion qui est à la fois au cœur de la vie morale et qui en même temps devient problématique dans notre société médiatique, où la pitié est sans cesse suscitée de façon parfois voyeuriste et presque toujours sans efficacité. Son analyse a d’abord le mérite de définir très précisément le concept en partant d’une étude du vocabulaire de la compassion. Elle est ensuite plus suggestive, mais renvoie aux ouvrages majeurs sur le sujet, puis elle ouvre sur les problématiques contemporaines, nous invitant à approfondir la réflexion par la lecture des ouvrages cités en bibliographie, en particulier sur le problème du « care ». Par le détour de l’étude d’un sentiment moral, c’est donc l’ensemble des problèmes sociaux qui concernent la médecine, la filiation, la condition animale, le rapport à la mort qui sont convoqués. On ne peut trouver d’enjeux plus contemporains.
Nathalie Godefroid