Sylvie Cuisin Boujac, Nietzsche et l’écriture de l’éternel retour, Publibook, Paris, 2011. (lu par Frédéric Porcher)
Par Jeanne Szpirglas le 13 février 2013, 06:00 - Psychanalyse - Lien permanent
 Sylvie Cuisin Boujac, Nietzsche et l’écriture de l’éternel retour, Publibook, Paris, 2011.
Sylvie Cuisin Boujac, Nietzsche et l’écriture de l’éternel retour, Publibook, Paris, 2011.
Issu d’une thèse soutenue à l’Université Paul-Valéry-Montpellier III (2008) sous la direction de J.-D. Causse (Département de psychanalyse), Nietzsche et l’écriture de l’éternel retour a pour projet de « trouver des liens permettant de mesurer un rapprochement aussi bien qu’un écart entre sa pensée (celle de Nietzsche) et celle de Freud et de la psychanalyse ».
Le rapprochement se justifie pleinement en ce que les deux penseurs impliquent une même « déconstruction » (p. 10) de la métaphysique. Mais Sylvie Cuisin Boujac annonce d’emblée son « parti pris de lecture » (p. 13 et 14) : relire la généalogie nietzschéenne comme « une forme historique » (p. 14) aboutissant à la pensée de l’« éternel retour » comme « pensée solitaire » où l’Autre et, à travers lui, le Symbolique - dont Lacan a établi le rôle constitutif pour la psyché - fait figure de grand absent. En sorte que l’articulation entre Nietzsche et Freud s’opère par le truchement de la psychanalyse lacanienne, notamment de son concept de « forclusion du Nom-du-père » qui, pour Sylvie Cuisin Boujac, représente le prix à payer de la philosophie nietzschéenne, ce qu’elle se propose d’analyser en partant de l’histoire conçue comme « éternel retour ». L’ouvrage réinterprétant l’éternel retour dans l’horizon de la forclusion du Signifiant et donc de la différence, soulève in fine la question très opaque de savoir pourquoi Nietzsche a pu « basculer dans la folie » (p. 14). Où l’on doit comprendre que si la pensée nietzschéenne cherche, comme la psychanalyse, à déconstruire le conscientialisme, « elle n’aboutit pas à ce qu’elle promet » (p. 386). Cette promesse déçue se trouve explicitée par l'auteur en termes d’incapacité à penser véritablement ce qu’elle veut déconstruire.
Le premier moment du livre (I/ Démystification nietzschéenne de l’histoire) tente de montrer cette incapacité à partir du processus de démystification de l’histoire engagé dès Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, poursuivi dans la Seconde considération inactuelle et la Généalogie de la morale, qui aboutit à « « re-mythologiser » l’histoire » (p. 79), faisant de cette dernière une fable portée par le mythe du héros dionysiaque, le « point de bascule » (p. 42) s’opérant en deux lieux distincts.
Le premier se trouve dans « l’écriture en aphorismes » en ce que la généalogie, posée par Nietzsche en lieu et place de l’histoire, « porte la métaphore à l’absolu » comme en témoigne l’aphorisme 327 d’Aurore dont Sylvie Cuisin Boujac donne une retraduction allant dans le sens d’un perspectivisme de l’absolu (p. 45 sq.). Cet absolu qui n’est pas tant ouvert par une absence que refermé sur un Être plein et divin (Dionysos), permet à l’auteur de déceler la « présence virtuelle de l’éternel retour » (p. 42) dès les considérations nietzschéennes sur l’histoire et la culture.
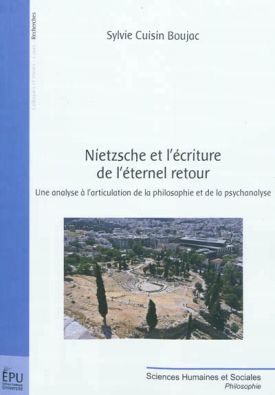 Le
second basculement de la critique en absolutisation se trouve dans la
redéfinition nietzschéenne de la « mémoire de la promesse »
(p.115) qui, pour Sylvie Cuisin Boujac, a ceci de spécifique, en
tant que « mémoire sans représentation », d’occulter
la trace écrite et donc le signifiant du Nom-du-père, de sorte
qu’elle finit par devenir une « mémoire de la volonté »
(Généalogie
de la morale)
que l'auteur relit comme mémoire sans passé et sans parole. Ce qui
suffit à démontrer que la critique nietzschéenne de l’histoire,
basculant dans l’absolutisation du mythe de l’origine (avant la
naissance et la castration), nous achemine vers la pensée de
l’éternel retour et du divin. En effet, l’ambivalence de la
position nietzschéenne se traduit finalement dans « la mort
de dieu », syntagme dont l’auteur rappelle le sens
chrétien et surtout paulinien pour opposer le Dieu du christianisme
et son « message athée » (Lacan), dont le sens se fonde sur
une absence et une négativité ouvrant à la parole, au « Dieu
de Nietzsche » (Dionysos) qui ne meurt pas (mémoire sans
trace, sans Verbe et donc sans promesse) prototype d’un « Dieu
de la psychose » (p. 171). Où l’on remarque qu’ici la
psychanalyse n’apparaît plus directement en dialogue avec la
pensée nietzschéenne mais en surplomb, comme si elle était à même
de dévoiler l’impensé de Nietzsche (l’Autre) et, du même coup,
la cause de son « effondrement ».
Le
second basculement de la critique en absolutisation se trouve dans la
redéfinition nietzschéenne de la « mémoire de la promesse »
(p.115) qui, pour Sylvie Cuisin Boujac, a ceci de spécifique, en
tant que « mémoire sans représentation », d’occulter
la trace écrite et donc le signifiant du Nom-du-père, de sorte
qu’elle finit par devenir une « mémoire de la volonté »
(Généalogie
de la morale)
que l'auteur relit comme mémoire sans passé et sans parole. Ce qui
suffit à démontrer que la critique nietzschéenne de l’histoire,
basculant dans l’absolutisation du mythe de l’origine (avant la
naissance et la castration), nous achemine vers la pensée de
l’éternel retour et du divin. En effet, l’ambivalence de la
position nietzschéenne se traduit finalement dans « la mort
de dieu », syntagme dont l’auteur rappelle le sens
chrétien et surtout paulinien pour opposer le Dieu du christianisme
et son « message athée » (Lacan), dont le sens se fonde sur
une absence et une négativité ouvrant à la parole, au « Dieu
de Nietzsche » (Dionysos) qui ne meurt pas (mémoire sans
trace, sans Verbe et donc sans promesse) prototype d’un « Dieu
de la psychose » (p. 171). Où l’on remarque qu’ici la
psychanalyse n’apparaît plus directement en dialogue avec la
pensée nietzschéenne mais en surplomb, comme si elle était à même
de dévoiler l’impensé de Nietzsche (l’Autre) et, du même coup,
la cause de son « effondrement ».
La seconde section du livre (II/ « Vers la forclusion du Nom-du-père ») s’attache à relire psychanalytiquement (sous l’angle de la forclusion) ce double mouvement paradoxal de critique et d’absolutisation de l’histoire en prenant pour fil conducteur la fonction du « mythe » en psychanalyse et chez Nietzsche. Après avoir rappelé son origine symbolique (l’Autre, le « Nom-du-père », le « Nom de Dieu ») pour la psychanalyse lacanienne, SCB. se demande pourquoi l’Autre est-il le grand absent de la philosophie nietzschéenne ? Autrement dit : pourquoi Dionysos, compris comme Dieu d’avant Socrate, Dieu d’avant la naissance, n’est-il pas inscrit dans la mort ? (p. 195 sq.) À cette question, l’auteur répond en déclarant que pour Nietzsche « Dieu est mort et n’est pas mort » (p. 270). Qu’est-ce à dire ?
Tant dans sa critique de l’histoire que dans son héroïsme aristocratique, le penseur de l’éternel retour demeure inflexiblement « dans le mythe de l’origine » (p. 187) qui a « pour nom Dionysos » (p. 205). Or le « mythe de Nietzsche » repose sur le refoulement de l’Autre et donc du « symbolique » dans sa pensée du temps (p. 231 sq.) comme dans celle du corps social (p. 280 sq.), ce qui fait bien de Nietzsche un authentique nihiliste à ceci près qu’après avoir diagnostiqué la mort de Dieu, celui-ci revient chez lui par la fenêtre de la psychose.
Le troisième et dernier moment du livre (III/ Nietzsche et la réalité) tire la conséquence de cette rémanence d’un Dieu sans altérité parce que sans manque à être, à un niveau qui n’est plus celui de la philosophie nietzschéenne mais de la personnalité de son auteur : comment « mettre en perspective ce que Nietzsche crée comme étant « sa réalité » avec ce qu’est la réalité, pour la psychanalyse » (p. 286) ?
En vue d’instruire cette question du rapport entre Nietzsche et la (ou sa) réalité, Sylvie Cuisin Boujac fait voir ce qu’elle nomme la « carence du symbolique » (p. 345 sq.) au sens où « l’inconscient nietzschéen n’a pas la structure d’un langage », que ce soit dans sa relation au mythe, à la foi et surtout à la « réalité sociale ». S’appuyant sur le contraste entre la société platonicienne et la « société dionysiaque divine » (p. 320), elle montre que la seconde, contrairement à la première qui suppose un ordre transcendant, se retourne en solitude et échoue, pour cela, à faire société et donc politique. Finalement, si Dionysos est, pour Nietzsche, l’être qui « l’habite depuis toujours et qu’il est lui-même », c’est en raison de son « oubli du refoulement primaire » (p. 346) et d’un narcissisme primitif non dépassé. Telle est la « différence essentielle avec Freud » (p. 375) que Sylvie Cuisin Boujac explique par une profonde dénégation de la négativité et de la mort, ce qui apparente sur ce point l’auteur du Zarathoustra à Spinoza. Dénégation qui serait finalement la cause de « l’enténèbrement de Nietzsche » (p. 318) et de son « échec à sortir de la solitude » (p. 377).
En cherchant à démêler la nature si complexe des liens entre Nietzsche et Freud, l’ouvrage de Sylvie Cuisin Boujac a le mérite de se confronter à la difficile question de savoir si « la conjonction » entre Nietzsche et la psychanalyse a encore un « avenir « (P-L, Assoun, Freud et Nietzsche, Préface à la 4ème édition). En suggérant de relire la philosophie nietzschéenne sous un angle psychanalytique, du reste plus lacanien que freudien, Sylvie Cuisin Boujac part bien de « l’articulation de la philosophie et de la psychanalyse » (sous-titre) mais il nous semble que progressivement elle tend à faire de la psychanalyse une clef analytique et clinique pour comprendre un Nietzsche en proie à la psychose. Auquel cas, ce n’est plus d’une « conjonction d’avenir » dont il s’agit, mais bel et bien d’une sorte de « psychanalyse posthume du philosophe », ce qui nous laisse un peu perplexe même s’il est vrai que « certains naissent posthumes… » (Antéchrist, Avant-propos).
Frédéric Porcher