Edouard Delruelle, De l’homme et du citoyen, introduction à la philosophie politique, Bruxelles, De Boeck, 2014, lu par Paul Sereni
Par Cyril Morana le 22 février 2016, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent
Chers lecteurs, chères lectrices,
Les recensions paraissent et disparaissent très vite ; il est ainsi fort possible que certaines vous aient échappé en dépit de l'intérêt qu'elles présentaient pour vous. Nous avons donc décidé de leur donner, à elles comme à vous, une seconde chance. Nous avons réparti en cinq champs philosophiques, les recensions : philosophie antique, philosophie morale, philosophie esthétique, philosophie des sciences et philosophique politiques. Pendant cinq semaines correspondant à ces champs, nous publierons l'index thématique des recensions publiées cette année et proposerons chaque jour une recension à la relecture. Au terme de ce temps de reprise, nous reprendrons à notre rythme habituel la publication de nouvelles recensions.
Recensions de philosophie politique
`Recensions de philosophie antique
Recensions de philosophie morale
 Edouard Delruelle, De l’homme et du citoyen, introduction à la philosophie politique, Bruxelles, De Boeck, 2014
Edouard Delruelle, De l’homme et du citoyen, introduction à la philosophie politique, Bruxelles, De Boeck, 2014
En 294 pages de texte courant (si l’on y inclut le « Lexique » final de noms propres et communs), l’ouvrage traite la question suivante : comment faire comprendre le sens et l’intérêt des principaux problèmes de philosophie politique, alors qu’on s’adresse à des lecteurs néophytes et, plus largement, à des non-spécialistes du domaine? Pour y répondre, le texte prend la forme d’un long dialogue fictif entre un auditeur ignorant ces questions et l’auteur, découpé en vingt chapitres nommés « séances ». On a choisi ici de retenir d’abord celles jugées les plus utiles, pour revenir ensuite sur les autres, en explicitant les raisons pour lesquelles elles ont paru plus discutables ou moins utilisables.
La séance 8, « Le théorème de Machiavel » est certainement l’une des meilleures. L’auteur éclaire la manière dont Machiavel dans Le prince traite le problème du pouvoir politique: il n’y cherche pas réellement à couper la politique de la morale. S’appuyant sur les travaux de Quentin Skinner et J. G. A. Pocock et sur une restitution synthétique de la conjoncture historique et de la biographie de Machiavel, nécessaire dans le cas précis, l’auteur montre qu’il s’agit dans Le prince, non « de liquider toute forme de morale, mais de critiquer la vision morale dominante, imprégnée de religion » (p. 77), de manière à faire place à la question du type de pouvoir capable de garantir la liberté des sujets et de l’Etat. Machiavel apparaît ainsi non seulement comme un penseur des rapports de pouvoir mais aussi en même temps comme un penseur de la liberté. Il l’est, toutefois, en déplaçant la position habituelle de la question. L’enjeu n’est plus « de savoir s’il vaut mieux un régime monarchique, républicain ou aristocratique, mais de déterminer comment s’organisent les rapports entre les forces sociales que sont le prince, le peuple et l’aristocratie » (p. 81). L’apport de Machiavel consiste dès lors à voir dans la politique le lieu du conflit organisé, non celui du dépassement des conflits : les luttes entre groupes sociaux sont incorporées « à la légitimité même de l’Etat » (p. 82), ce qui explique le titre de la séance, repris d’un article de Balibar.
La séance 15 (« La séquence française : la liberté radicale (2) Foucault ») est entièrement consacrée aux apports de Foucault à la question du pouvoir. Pour l’auteur, ils tiennent pour l’essentiel en trois points. D’une manière volontairement opposée celle de Hobbes dans le Léviathan (et à toute la tradition dans laquelle on peut inscrire ce texte), Foucault a cherché, non comment un pouvoir souverain émerge d’une union des volontés individuelles, pour animer le corps politique, mais comment les individus sont formés par des rapports de pouvoir disséminés dans la culture d’une société. Cela l’a amené à se pencher sur la manière dont des pouvoirs s’instituent en excluant certaines formes d’existence et en créant des catégories négatives (le fou, le délinquant, etc.). L’auteur remet ainsi en perspective Histoire de la folie à l’âge classique, prévenant le contresens qui en ferait un texte antipsychiatrique : « Foucault fait tourner le décor, étudiant une culture non par ce qu’elle institue et valorise au niveau « conscient » mais par ce qu’elle exclut, rejette, par ses « cases négatives » » (p. 163).
Le deuxième apport important consiste à repérer l’émergence d’un nouveau pouvoir, le pouvoir « biopolitique » (terme qui n’a pas été inventé par Foucault, mais auquel il a donné un sens spécifique) ou « biopouvoir » : il prend en charge la gestion, au sens large, d’un flux de population, par le biais de systèmes d’assurance, de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance et, en somme, par un quadrillage plus ou moins sensible des existences individuelles. On se retrouve ainsi, effectivement, assez loin du Léviathan de Hobbes et des théories classiques du pacte social.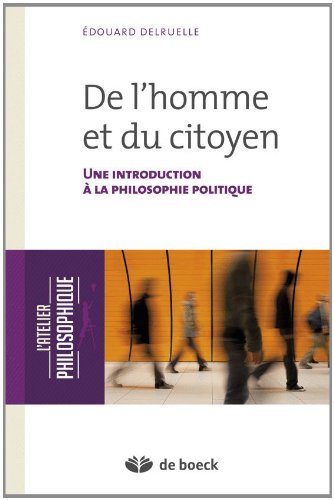
Le troisième apport consiste à montrer que certaines doctrines économiques récentes néo-classiques (alors très peu connues du public français) sont à la fois des théories de la production et de la circulation des biens, des politiques économiques en faveur du marché concurrentiel comme mode de régulation sociale, et des politiques tout court, qui tendent à réorganiser la société.
La séance qui suit est fort logiquement consacrée à répondre à la question « qu’est-ce que le néo-libéralisme ? », en exploitant le contenu du cours donné par Foucault en 1978/79 au Collège de France, intitulé « Naissance de la biopolitique » (publié sous ce titre en 2004). Si le texte de Foucault traite pour une très large part de l’ordo-libéralisme allemand, l’auteur montre que les néolibéraux en général tendent à instituer un nouveau type de rapport social, fondé au moins autant sur la concurrence que sur l’échange, en assumant tout à fait explicitement qu’il s’agit de créer un ordre, et non d’attendre qu’il s’impose naturellement : « (…) c’est un point central : la concurrence n’est pas du tout une donnée primitive, mais le résultat de conditions qui auront été aménagées » (p. 176). L’analyse rejoint pleinement celle de Dardot et Laval dans La nouvelle raison du monde (2009), elle même, il est vrai, largement appuyée sur le travail de Foucault.
La séance 19 (et avant-dernière), « Liberté, égalité, civilité » reprend explicitement, pour l’essentiel, l’argument d’Etienne Balibar dans La proposition de l’égaliberté (2010). Proposant une relecture de la Déclaration des droits de l’homme, Balibar montre qu’il faut d’abord lire ce type de texte comme un ensemble de performatifs de portée universelle : « (…) il ne décrit pas des droits existants naturellement, il modifie la réalité politique en les affirmant » (p.213).
Ces performatifs instituent un nouveau rapport à autrui. Cette lecture s’oppose donc nettement aux critiques des droits de l’homme qui y voient une sanction de l’individu détaché du groupe et l’expression d’une forme d’individualisme anti-communautaire. « Il faut garder à l’esprit que la liberté n’est pas une propriété individuelle, mais une relation à autrui » (p. 214). Si ceci est correct, il en ressort que l’exigence de liberté ne peut être séparée de celle d’égalité : « si la liberté n’est pas égalité, si je suis libre d’être le maître d’autrui, alors lui n’est pas libre, et ma liberté est pour lui assujettissement (ce qui est contradictoire) » (p.214). L’auteur montre ainsi la nouveauté et l’intérêt de cette relecture, qui justifie le néologisme, obtenu par contraction, de « égaliberté ».
Un lexique complète utilement (par exemple à travers la définition de «performatif ») le texte courant.
°°°
Certes, on pourra trouver des remarques pertinentes et utiles à d’autres endroits du texte. Ainsi, la séance 6 résume l’approche de la démocratie grecque antique par Castoriadis en montrant qu’elle est le projet de se donner des lois (autonomia), ce qui suppose l’égalité devant la loi (isonomia), l’égalité de parole (iségoria) et la possibilité de parler sincèrement devant l’assemblée du peuple (parrhésia) (p. 53). De même, la séance 10 (« la « révolution » Rousseau ») montre que, si dans les théories classiques du pacte social, il y a deux termes (l’état de nature et le pacte), Rousseau propose un schéma à trois termes : un état de nature presque vide, un premier contrat, inique, et un second contrat qui doit opérer une transformation morale de l’homme.
Cependant, si beaucoup de chapitres n’ont pas été retenus, c’est qu’ils ont paru plus superficiels, plus discutables ou les deux. Ainsi, dans le chapitre 9, « La séquence anglaise : l’invention du libéralisme », on retrouve l’idée selon laquelle Locke serait le père du libéralisme politique et d’un certain libéralisme économique, son texte offrant une version raisonnable du contrat selon Hobbes, lui-même vu comme un des fondateurs du libéralisme. Les relectures relativement récentes de Locke ont pourtant montré que ces deux idées étaient peut-être des reconstructions postérieures, devenues des poncifs. Dans le même sens, même chapitre, l’auteur reprend la distinction entre une liberté dite négative (conçue comme non-domination et non-interférence) et une liberté dite positive (conçue comme participation à un collectif autonome). Mais ici deux questions au moins se posent : 1) faut-il accepter telle quelle cette distinction ? 2) Peut-on l’appliquer à Locke ? Dans le même ordre d’idées, la séance 13, consacrée aux apports de la psychanalyse, soutient que le statut social acquis par la psychanalyse tient à sa capacité « magicienne », bien plus qu’à « la confirmation scientifique de ses résultats cliniques, à peu près nulle » (p. 138). On peut y voir une affirmation à l’emporte-pièce : si ce n’est peut-être pas à cause de son statut scientifique que la psychanalyse a acquis son statut social, cela n’implique pas que sa confirmation scientifique soit quasi-nulle.
°°°
On peut se demander si ces inégalités de contenu ne tiennent pas au type d’exercice tenté par l’auteur, qui est à mi-chemin entre la synthèse, pour partie historique, destinée au plus grand public et l’essai dialogué. Si l’on comprend bien l’intention, la forme choisie rend peut-être difficile de trouver un équilibre entre les différentes exigences inhérentes à ce genre de tentative (par exemple : précision mais concision, simplicité sans déformation). Ainsi, dans le chapitre où figure le résumé de l’approche de Castoriadis, l’auteur ne peut naturellement pas faire de place à la notion un peu difficile d’imaginaire social ou d’imaginaire instituant, qui explique cette approche. Mais, dans ce cas, on peut se demander si un lecteur non familiarisé peut réellement comprendre. Dans le même sens, on peut aussi se demander si, dans plusieurs chapitres, le texte touche le public visé. Ainsi, la séance sur la psychanalyse déjà citée multiplie les références et les prises de position, ce qui la rend faussement simple : un lecteur qui n’est pas déjà au fait de la question risque de ne pas s’y retrouver. De nouveau, il s’agit peut-être surtout là de problèmes posés par la forme choisie pour atteindre le but.
Ces réserves ne doivent évidemment pas masquer le fait que bon nombre de chapitres et de remarques constituent un utile instrument de travail, complétés par une bibliographie sélective (incluse dans le « Lexique ») très pertinente.
Paul Sereni