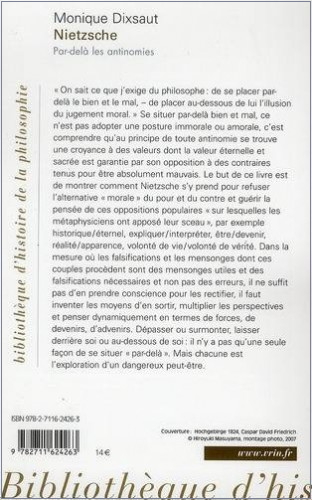Monique Dixsaut, Nietzsche, Vrin 2012, lu par Jérôme Jardry
Par Jeanne Szpirglas le 02 juillet 2019, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
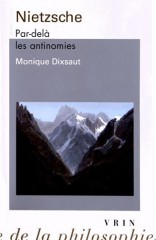 Monique Dixsaut, Nietzsche. Par-delà les antinomies, collection Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie, Vrin, septembre 2012, réimpression de l'édition 2006 chez Transparence (480 pages). Lu par Jérôme Jardry.
Monique Dixsaut, Nietzsche. Par-delà les antinomies, collection Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie, Vrin, septembre 2012, réimpression de l'édition 2006 chez Transparence (480 pages). Lu par Jérôme Jardry.
Contredire n’est pas seulement dialectique, au sens hégélien, et il faut apprendre à lire, par-delà les interprétations qui recouvrent la philosophie de Nietzsche. Il est, après Platon, l'autre auteur de prédilection de Monique Dixsaut.
Nietzsche par-delà les antinomies est une réédition et reprend les éléments d'un cours d'agrégation que Monique Dixsaut a donné à la Sorbonne en 1999-2000. Elle s'était imposée de faire ce cours, remettant à l'année suivante celui sur Plotin, également au programme cette année-là. Son devoir n'était pas qu'envers ses étudiants, toujours plus nombreux, de présenter un commentaire d'Histoire de la philosophie de qualité, mais envers elle-même et envers son auteur : si Monique Dixsaut a maintes fois parlé de « son » Platon, il y a évidemment aussi « son » Nietzsche. Le cours est devenu livre, mais la forme« écrit-parlé » est en partie conservée ; de même des « explications de texte » affrontent la lettre du texte de Nietzsche. C'est un risque, comme les étudiants, et les professeurs le savent bien : il faut, pour paraphraser P. Wotling, que M. Dixsaut cite p. 55, supporter cette « épreuve de vérité » qu'est l'explication de texte. Cet ouvrage a le souci de comprendre Nietzsche et de le faire comprendre ; l'exercice de l'explication de texte implique également, « s'agissant de Nietzsche », de « ne pas se tromper sur qui il est. Expliquer un de ses textes, c'est lui rendre justice ». Ce « rendre justice » revêt un sens spécifique avec Nietzsche : il s'agit de l'exigence fondamentale pour le lire. Mais un cours d'Histoire de la philosophie (pour l'agrégation), qui présente un Nietzsche “inédit”, constitue à coup sûr un paradoxe.
L'ouvrage de Monique Dixsaut établit que l'art de contredire, qui est celui de Nietzsche, est tout sauf dialectique, au sens hégélien du terme. La dialectique, d'Aristote à Hegel, se soumet en effet au principe de contradiction, mais ce principe est psychologique, et non pas logique. Soit alors une connaissance est possible du réel, indépendamment de ce principe —ce qui est impossible parce que ce principe est fondateur de toute connaissance—, soit, alors, le principe de contradiction ne relève que d'une pétition de principe : « la logique serait un impératif, non pour la connaissance du vrai, mais pour poser et accommoder un monde censé s'appeler pour nous le monde vrai » (fr. XIII, 9[97], automne 1887, cité p. 35). La contradiction quitte le domaine de la logique pour accéder au domaine de la culture, et Nietzsche fait coexister les contradictoires : « pouvoir supporter la contradiction », et : « la contradiction […]—ni logique, ni historique— est tragique, et c'est parce qu'elle l'est qu'elle peut se vivre, s'expérimenter et s'affirmer joyeusement » (p. 55).
La première partie (« interpréter ») reprend la question de l'antinomie du point de vue du texte et de l'interprétation : « il faut apprendre à lire Nietzsche, c'est lui qui nous le dit » (p. 59). Les antinomies structurent la philosophie de Nietzsche, et concernent en fait toute lecture. La première antinomie est celle de l'histoire (« pourquoi s'intéresser à un fait passé? »), opposant l'historique et le non-historique, l'Histoire et la Vie. L'antinomie ne se dépasse pas dans une réconciliation et un dépassement : l'antinomie doit laisser la place au conflit légitime entre les deux termes, qui a l'avantage de pluraliser l'histoire (de même que la « vie » : « se méfier du singulier grammatical qui signifie tout le contraire d'une singularité », p. 70), et de retrouver le sens fondamental de la vie comme puissance créatrice (« la vie n'est pas une essence », p. 71). L'antinomie de l'histoire de la philosophie consiste à opposer une histoire continue correspondant à un temps homogène à une histoire de la philosophie critique de tout ce qui précède : ni continuités, ni contradictions dépassées, l'histoire de la philosophie est avant tout une histoire de philosophes. La dernière antinomie abordée dans cette partie est celle que résout la philologie, comme art, justement, de bien lire ; elle répond ainsi, dans son sens rénové —parce qu'il y a une philologie contre laquelle on peut être, celle qui n'est qu'un historicisme— aux attaques contre La Naissance de la tragédie, posant comme exigence de penser l'Antiquité à partir de l'Antiquité, et non pas à partir du présent, comme le fait toute lecture qui croit qu'elle a raison dans toutes ses opinions courantes. La philologie donne une signification à la « philosophie » chez Nietzsche : si la philologie au sens large manque de philosophie, plus radicalement, les philosophes manquent de philologie (p. 126). La philosophie est en effet un « art de bien lire ».
La question de l'interprétation oriente vers l'opposition du texte et de ce qu'on a pris pour un texte. Le monde est un chaos, parce qu'il est pris pour un texte alors qu'il n'en est pas un. C'est ce qui autorise « l'antinomie des deux mondes », titre de la deuxième partie de l'ouvrage de Monique Dixsaut. Tandis que la première partie entendait relever les erreurs dont la racine se trouve dans le problème de la lecture, la deuxième partie montre que de nouvelles antinomies mettent à jour cette fois des « mensonges » : on passe ainsi des mauvaises lectures aux falsifications. Il s'agit de l'antinomie de l'être et du devenir, l'indigence et la surabondance de forces, de l'antinomie de la réalité et de l'apparence, érigeant la vérité au rang de « valeur » fondamentale, au profit, donc, de la « fable du monde vrai ».
La dernière partie est consacrée à la dernière antinomie, celle de la morale, qui est la plus fondamentale de toutes, mais elle est articulée à la précédente antinomie, et à la question de la valeur de la vérité. L'examen de l'antinomie de la morale conduit à un dépassement à venir, celui du surhumain, qui est une « réévaluation » (Umwerthung) des valeurs, un « contre-idéal », parce que la question de la morale se résout finalement d'une part dans la reconnaissance du problème de la valeur de la vérité , et d'autre part dans l'analyse du nihilisme. Il faut distinguer à cet égard deux nihilismes (et seulement deux) : un « nihilisme actif » et un « nihilisme passif » (fr. XIII, 9[35]) : l'un attaque et détruit tandis que l'autre se contente de ne plus croire. Exit un nihilisme « réactif » : toute force est l'expression d'une volonté de puissance et une forme de l'agir, même quand elle « réagit ». Gilles Deleuze voit en effet une « dévalorisation » là où Nietzsche parle de « destruction », et « Deleuze convertit le nihilisme actif (qui brille chez lui par son absence) en nihilisme réactif » (p. 397).
Pourquoi fallait-il que Monique Dixsaut propose son Nietzsche ? Rien ne l'exigeait, et elle écrivait d'ailleurs déjà en juillet 1994, pour la réédition du Naturel philosophe : « Bergson écrit : “nul n'est jamais tenu de faire un livre”— il serait assurément absurde de se croire tenu d'en refaire un. Et j'ai le mauvais goût de suivre Nietzsche (constamment présent en arrière de ce travail comme intercesseur paradoxal) en n'aimant pas les livres qui ne sentent que l'encre et le papier ». Il faut comprendre Nietzsche en philologue, et M. Dixsaut retient cette leçon : “Nietzsche n'emploie jamais l'expression « forces réactives ”. Pour les œuvres publiées, l'adjectif reaktiv n'est présent que dans deux pages de La Généalogie de la morale consacrées à la justice (II, §ii)... » (p. 283). En “redressant” l'analyse deleuzienne, Monique Dixsaut donne une leçon fondamentale sur Nietzsche, en suivant sa parole même : « je ne suis pas assez borné pour un système », XIII, 10 [145]). Il y a effectivement des philosophes, dont sont Nietzsche et Platon, qui ne se mettent pas en systèmes. Ils partagent également ce caractère de résister à toute tentation d'une lecture métaphysique, parce que leur pensée n'hypostasie aucun principe et pour cette autre raison qu'ils questionnent, peut-être plus fondamentalement que tous les autres, le problème de ce que c'est qu'être « philosophe ». En ce sens, fondamentalement, c'est contre le Nietzsche de Heidegger que M. Dixsaut parle du sien. La clé est évidemment à trouver dans la filiation de Platon à Nietzsche, les seuls philosophes à dire, avec Socrate, « demain », ce qui s'oppose le mieux à toute lecture métaphysicienne.
 Le Nietzsche de Monique Dixsaut cherche à faire entendre qui est Nietzsche, par-delà les lectures dialectiques (hégéliennes), deleuziennes, qui figent toujours le philosophe derrière l'affichage d'une apparence de système. C'est que Nietzsche (ou Platon) dût entrer dans une « Histoire de la philosophie » qui était un paradoxe, puisqu'il n'y a pas de philosophes qui soient plus « inactuels ». Une histoire de la philosophie historienne ou systématique ne peut donc rien comprendre de Nietzsche, si c'est finalement le dionysiaque et le tragique qui rendent compte du philosophos.
Le Nietzsche de Monique Dixsaut cherche à faire entendre qui est Nietzsche, par-delà les lectures dialectiques (hégéliennes), deleuziennes, qui figent toujours le philosophe derrière l'affichage d'une apparence de système. C'est que Nietzsche (ou Platon) dût entrer dans une « Histoire de la philosophie » qui était un paradoxe, puisqu'il n'y a pas de philosophes qui soient plus « inactuels ». Une histoire de la philosophie historienne ou systématique ne peut donc rien comprendre de Nietzsche, si c'est finalement le dionysiaque et le tragique qui rendent compte du philosophos.
Pas plus Platon que Nietzsche ne sont des philosophes comme les autres. Quel mépris, dira-t-on, et quelle condescendance à affirmer une telle chose, et pourtant ! Ils impliquent l'un et l'autre un type de lecture très particulier, qui hésite entre deux excès, l'un consistant à les lire « de l'extérieur » et à croire qu'ils mettent en œuvre des « concepts », organisés en « système », pour une « doctrine ». L'autre excès consiste à partager leur « exaltation » et à imiter leur « style ». Cette lecture des effets de la philosophie de Nietzsche (et de Platon) est largement assumée, humblement, par Monique Dixsaut (p. 55). C'est le principe même de l'interprétation de la philosophie de Nietzsche, la « réserve » que Nietzsche impose à son lecteur : il faut à la fois éviter de figer les termes en « concepts », et il faut éviter de tomber dans l'exaltation qui résulte de la jubilation de la pensée. Mais « rendre justice à Nietzsche », c'est aussi le faire conformément à la prescription de notre auteur, cité p. 56 : « Ne faut-il pas de la chaleur et de l'enthousiasme pour rendre justice à une chose qui relève de la pensée ? —et c'est précisément là ce qui s'appelle voir » (Aurore, V, §539).
Jérôme Jardry